Oh la la, qu’est-ce que c’est que cette idée absurde ? Être léger en montagne, un désavantage ? Laissez-moi vous expliquer ce paradoxe ! Les lois de la physique ne plaisantent pas, et elles peuvent jouer contre les grimpeurs au profil léger face à des poids lourds en pleine ascension ! Pensez à Miguel Indurain, avec ses 78,5 kg pour 1m88, ou à des mastodontes comme Jan Ullrich et Lance Armstrong, affichant 74 kg. Ces coureurs, pourtant considérés comme « lourds », ont en réalité un avantage indéniable que vous allez bientôt comprendre.
L’exemple du rouleur
Si l’on considère deux cyclistes, l’un pesant 58 kg et l’autre 78 kg, présentant une puissance maximale relative identique de 6 watts par kg sur une période de 20 minutes, on constate que le premier génère une puissance de 6×58=348 watts, tandis que le second atteint 78×6=468 watts.
Sur un terrain plat, un coureur générant 468 watts est en mesure d’atteindre des vitesses beaucoup plus élevées, car sa masse ne constitue qu’un léger obstacle à sa progression. Il possède une puissance absolue supérieure de 120 watts par rapport à ses concurrents. C’est pourquoi il est rare de voir des athlètes de moins de 60 kg remporter des contre-la-montre sur le Tour de France. Bien que certains coureurs légers puissent réaliser de bonnes performances, cela est généralement dû à un aérodynamisme exceptionnel qui compense leur poids. C’est le cas de Remco Evenepoel qui pèse environ 61 kg pour 1m71.
Pour que les cyclistes légers puissent rivaliser efficacement avec les coureurs de poids supérieur, il est nécessaire que la pente soit significative, et dans certains cas, elle doit atteindre des niveaux très élevés, entre 12 et 15 %. Dans de telles conditions, le poids léger devient un atout. En revanche, pour des inclinaisons se situant entre 5 et 8 %, comme dans l’exemple cité, le coureur pesant 58 kg ne bénéficiera pas d’un avantage comparatif.
De plus, avec un poids maximum des vélos fixé à 6,8 kg, un coureur pesant 58 kg devra transporter un vélo représentant 11,7 % de son poids corporel, tandis qu’un coureur de 78 kg n’aura qu’un vélo équivalant à 8,7 % de son poids corporel.
Testez cela avec notre calculateur
Ci-dessous, vous pouvez évaluer la performance de deux cyclistes sur un col similaire à celui de l’Alpe d’Huez. Il est observable qu’à puissance relative équivalente, un cycliste pesant 58 kg subirait une perte de temps d’environ 45 secondes à 1’30 » par rapport à un cycliste pesant 78 kg, en tenant compte de leurs coefficients de traînée aérodynamique respectifs.
Comparaison entre deux cyclistes
Coureur Léger
Coureur Lourd

Se pose alors une question, est ce que les sportifs de petite taille dispose d'un VO2max relatif en ml/min/kg plus élevé que les grand gabarit ? Ce qui leurs permettraient de compenser se désavantage frappant.
Le VO2max des petits gabarits est relativement plus élevés
De nombreux travaux confirment que les individus de plus petit gabarit (poids et surtout surface corporelle) présentent souvent un VO₂max relatif (ml/kg/min) plus élevé que des individus plus grands et plus lourds.
Bergh et al. (1991) : dans un papier célèbre sur la course à pied, montrent que les meilleurs coureurs de fond légers présentent des VO₂max >85 ml/kg/min, alors que les coureurs plus lourds plafonnent en moyenne à 70–75 ml/kg/min, même à niveau similaire.
👉 Ce constat provient principalement de deux phénomènes bien documentés :
1️⃣ Masse métabolique active proportionnellement plus grande chez les petits individus
- Chez un petit sujet, la proportion de masse musculaire active (par rapport au poids total) est souvent plus élevée.
- Les muscles des jambes étant le principal moteur de la consommation d’O₂ en course ou en vélo, cela favorise un VO₂max relatif plus élevé.
2️⃣ Rapports allométriques défavorables aux grands individus
- La surface corporelle (et donc la capacité de dissiper la chaleur) croit au carré de la taille, alors que la masse augmente au cube.
- Cela engendre un « handicap allométrique » : les sujets plus grands doivent transporter plus de masse par unité de surface, ce qui limite la performance aérobie relative (W/kg et ml/kg/min).
📚 Références principales
✅ Åstrand & Rodahl (1986) – Textbook of Work Physiology
➔ Ouvrage fondateur expliquant les bases physiologiques du VO₂max, et la relation inverse entre poids corporel et VO₂max relatif.
✅ Bergh, A., et al. (1991) – “Body size and running economy in elite distance runners” (Medicine & Science in Sports & Exercise).
➔ Montre que les coureurs plus petits présentent systématiquement un VO₂max relatif plus élevé pour une performance donnée.
✅ Daniels, J., & Daniels, N. (1994) – “Running economy of elite male and elite female runners” (Medicine & Science in Sports & Exercise).
➔ Donne des valeurs mesurées de VO₂max très élevées chez des coureurs légers et compare les sexes.
✅ Lucia, A., et al. (2001) – “Physiology of professional road cycling” (Sports Medicine).
➔ Étude sur cyclistes pro : grimpeurs plus légers = VO₂max relatifs de 80–90 ml/kg/min vs rouleurs 70–75 ml/kg/min.
📄 1. Bergh et al. (1991) – "The relationship between body mass and oxygen uptake during running in humans"
- Montre que l’augmentation du VO₂max et du VO₂submax n’est pas linéaire avec la masse corporelle : l’exposant b est <1 (~0,71 pour VO₂max), inversant la relation entre poids et VO₂/kg core.ac.ukpezcyclingnews.com+15researchgate.net+15faculty.washington.edu+15.

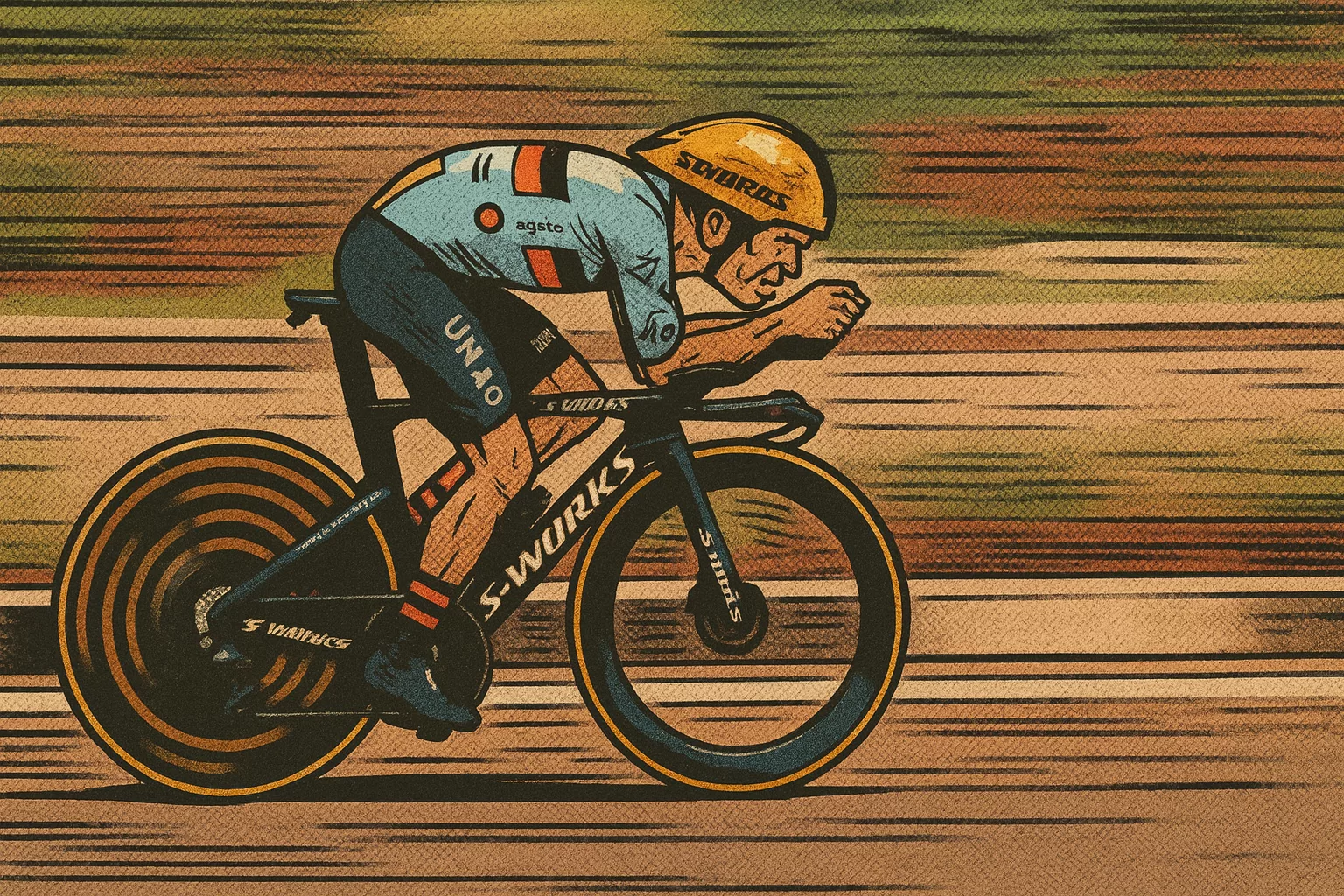
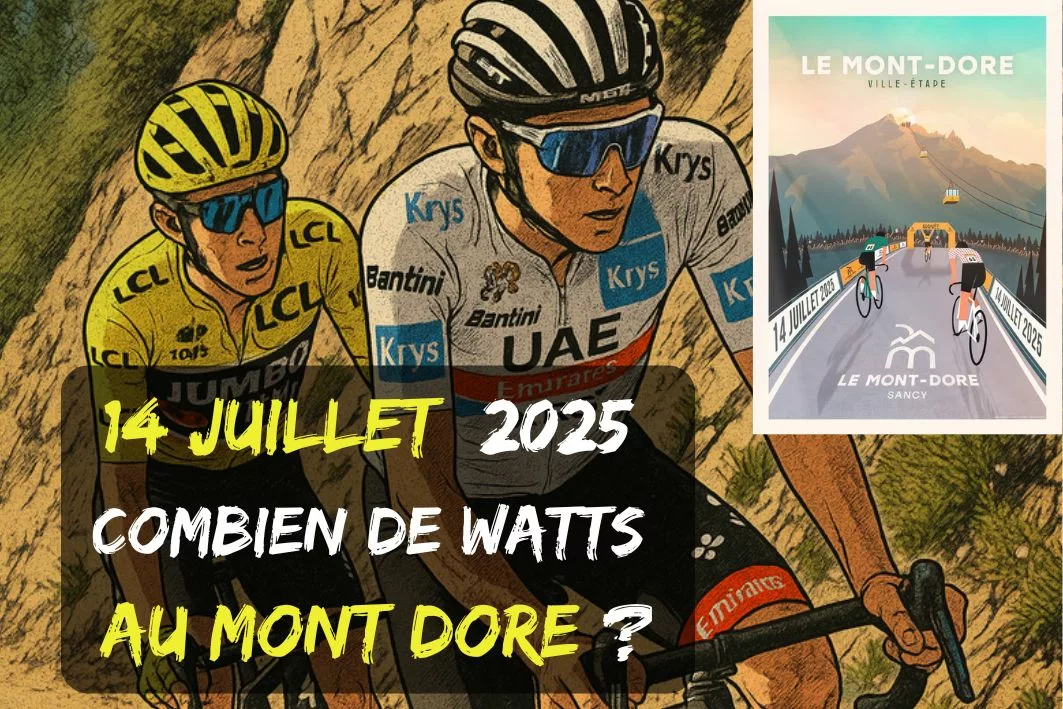
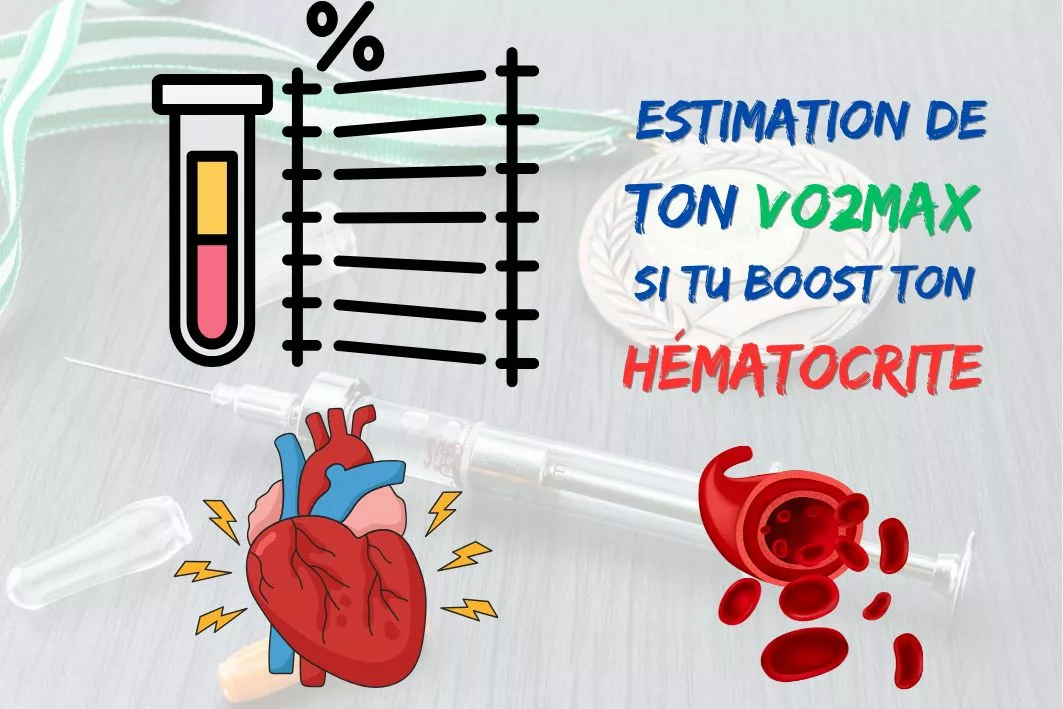
Excellent article comme d’habitude, sourcé et documenté ! Mais ne perdons par de vue que les exemples cités comme le « grand Miguel » et le « gros Yann » ont tous deux bénéficié d’une aide exogène non négligeable… Tu me diras, les grimpeurs de l’époque aussi. Il aurait été intéressant de les confronter « au naturel » pour avoir un élément de comparaison avec les éléments de cet article. Ce serait valable pour les coureurs d’aujourd’hui aussi.
Ça dit qu’a puissance relative maximale fixée, il est plus avantageux d’être lourd que léger, et ce d’autant plus que le terrain est plat. Mais le fait de fixer la puissance relative maximale est un peu arbitraire, non ? Pour un coureur donné, le fait de perdre ou de gagner du poids va modifier sa puissance relative maximale relative, et donc sa puissance maximale (pas relative) ne sera pas proportionnelle à son poids (sinon, pour être performant sur du plat, il suffirait d’être le plus lourd possible: ça se saurait, si les lutteurs de sumo avaient le profil idéal pour être de bons rouleurs…)
Attention, on parle de sportifs de masse différente, mais dont l’origine de l’écart n’est pas un surpoids. On prend deux cyclistes affutés et le plus lourd dispose d’un avantage.
On trouve beaucoup sur des forums des questionnements sur le poids, mais aussi la puissance, développé dans le vélo féminin. Avez vous des articles prévus là dessus? Entre la sortie sur les cyclistes trop légères et la monté de PFP qui distance largement ses concurrentes, il y a de quoi développer un sujet, non?