Cet article pose les bases de ce qui nous permet de détecter des performances « extra-physiologiques ». Il ne permet pas de détecter des performances douteuses d’un cycliste de niveau modeste qui aurait recours au dopage, car le modèle vise les performances humaines historiques maximales avec ou sans dopage. Ce sont donc les performances record des cyclistes du Tour de France ou des autres grandes épreuves de montagne qui sont ciblées par notre modélisation. Le modèle n’est pas infaillible, il est là pour nous aider dans l’analyse et l’interprétation.
Pour réaliser cet outil, nous nous appuyons sur 60 ans d’histoire de la science des sports d’endurance. L’endurance aérobie est analysée depuis les années 1960 et nous avons pu voir l’impact du dopage sanguin massif dans les années 1990 avec l’EPO. Cela permet de connaître très précisément les limites du corps humain, basé sur des décennies de données sur des milliers de cyclistes faisant partie de l’élite mondiale. De plus, nous nous appuyons aussi sur une vaste étude effectuée entre 2013 et 2021 sur 4 équipes cyclistes professionnelles, dont deux équipes PRO TOUR. Cette dernière a collecté les puissances des cyclistes pour dresser le profil de puissance record des meilleurs cyclistes du monde. Cette période entre 2013 et 2021 est particulièrement intéressante, car elle est marquée par un recul sensible des performances des cyclistes professionnels par rapport aux années 1990 à 2010, marquant la fin de l’ère Armstrong. Ce qui ne veut pas dire qu’aucun cycliste n’était dopé au cours de cette étude, mais cela pose des repères qui sont représentatifs des limites hautes des capacités maximales humaines. Il est probable que des cyclistes ayant eut recours au dopage furent inclus dans l’étude, c’est pourquoi les valeurs records enregistrées dans cette étude sont probablement un peu au dessus des limites physiologiques de l’ordre 1 à 2% peut être.

Enfin, nous nous appuyons sur les lois immuables de la physique et de la chimie cellulaires énergétiques qui permettent de calculer la puissance et le VO2max avec presque autant de précision que les lois gravitationnelles. Nous vous invitons donc à découvrir la méthode dans cette vidéo et à tester nos outils.

Le rendement des cyclistes est bien connu dans la littérature scientifique. En effet, les cyclistes élites présentent un rendement de 21 à 24 %. Nous n’avons aucun exemple mesuré au-delà de ces valeurs. Le rendement, c’est le rapport entre l’énergie mécanique (watts sur les pédales) et l’énergie biochimique qui est en lien direct avec la consommation d’oxygène. Les données scientifiques nous apprennent également qu’il y a une relation inverse entre le rendement et le VO2max. Ce qui veut dire que plus le cycliste dispose d’un très haut VO2max, plus son rendement tend à diminuer. Il est donc très improbable de trouver un cycliste disposant de 92 ml/min/kg avec un rendement supérieur à 24 %. C’est comme ci notre organisme développait un haut VO2max pour compenser une efficacité métabolique moindre. Ce phénomène est important, car il nous indique clairement qu’il y a des limites à la performances humaines aérobies. On ne verra pas les performances croitre indéfiniment, sauf avec l’aide du dopage ou la technologie.
La chaleur est un paramètre dont il faut tenir compte. Par exemple, lors de la montée de Valmeinier pendant le Dauphiné Libéré 2025, il faisait 29° degrés en moyenne, ce qui rend l’effort bien plus difficile qu’avec une température de 20°. Diverses études 1 2 3 ont montré une baisse du VO2max et de l’endurance pour des efforts réalisées dans des ambiances chaudes de l’ordre de 30°. La perte de puissance observé fluctue entre 6 et 8 %. Chez les sportifs élites, et acclimatés à la chaleur, la perte d’endurance et de VO2max peut être de l’ordre de 2 à 4%. Il est en revanche impossible de ne pas subir d’altération de la performance aérobie en ambiance chaude. Aucun record du monde sur 10 000 m ou marathon n’a été battue pour des températures de 30°. Dans un col hors catégorie les vitesses des cyclistes sont de l’ordre de celle des coureurs de 10 000 m ou de marathon, le refroidissement par convection lié au déplacement dans l’air est du même ordre.
Il en est de même avec l’altitude, même en étant entrainé, la perte de puissance par rapport au niveau de la mer est inévitable, de très nombreuses études l’ont démontré. L’une d’entre elle4 met en évidence une perte de 6% de puissance tous les 1000 m à partir 800 mètres d’altitude. On peut par exemple constater que les puissances extrême calculer par divers spécialistes comme Portoleau ne sont jamais observé sur des col comme le Galibier dont l’altitude moyenne depuis le Lautaret est de 2350 m. On peut envisager que chez les cyclistes professionnelles, cette perte de puissance est réduite de l’ordre de 3% au lieu de 6%.

Quelques Références :
- Jiexiu Zhao, Santiago Lorenzo, Nan An, Wenping Feng, Lili Lai, Shuqiang Cui,
Effects of heat and different humidity levels on aerobic and anaerobic exercise performance in athletes, Journal of Exercise Science & Fitness, Volume 11, Issue 1, 2013, Pages 35-41, ISSN 1728-869X, https://doi.org/10.1016/j.jesf.2013.04.002. ↩︎ - Carlota Pardo Atarés, Effects of Heat and Humidity on Cycling Training and Performance: A Narrative Review, Journal of sciences and cycling, 28 nov 2023 ↩︎
- González-Alonso, José & Teller, Christina & Andersen, Signe & Jensen, Frank & Hyldig, Tino & Nielsen, Bodil. (1999). Influence of body temperature on development of fatigue during prolonged exercise in the heat. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985). 86. 1032-9. 10.1152/jappl.1999.86.3.1032. ↩︎
- Wehrlin, J.P., Hallén, J. Linear decrease in VO2max and performance with increasing altitude in endurance athletes. Eur J Appl Physiol 96, 404–412 (2006). https://doi.org/10.1007/s00421-005-0081-9 ↩︎
En savoir plus sur Velo2max.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


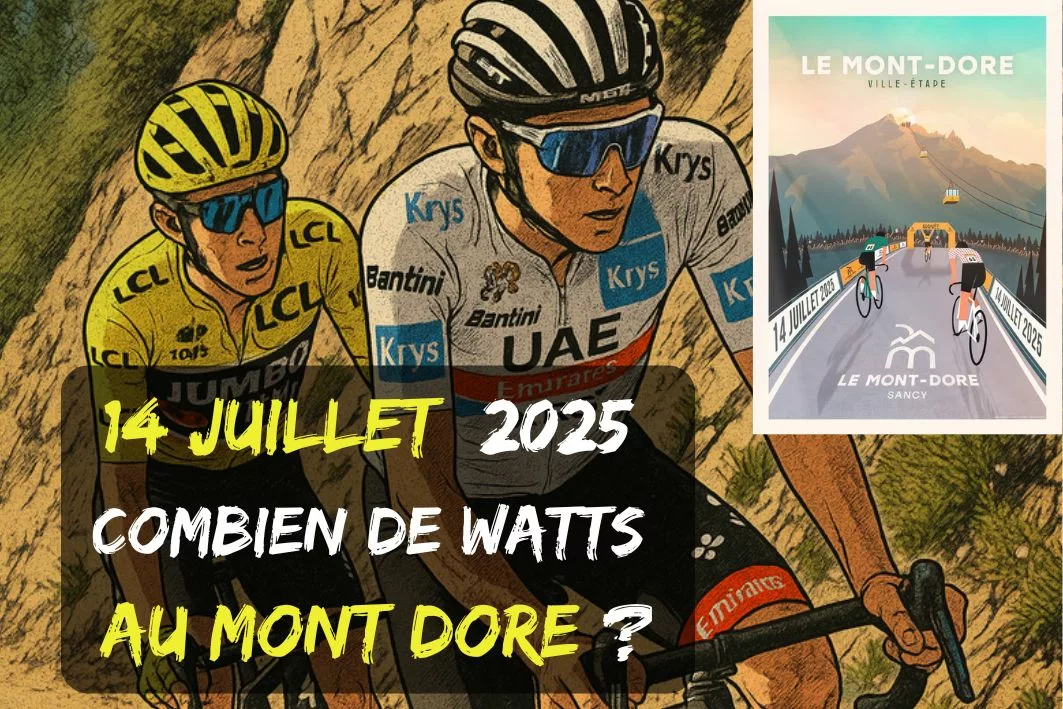
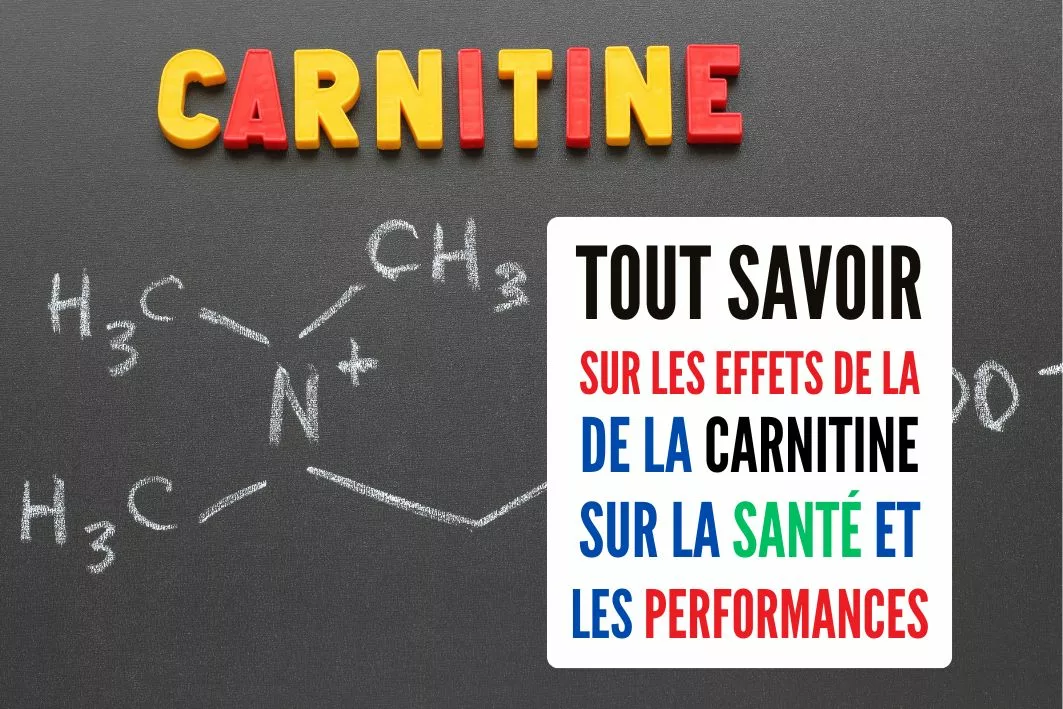
Bonjour,
Je souscris complètement à votre commentaire en fin de vidéo. L’éthique, aussi bien sa recherche que sa protection, ne forme aucunement le socle de notre société. L’avantage : ça ne peut pas durer ; l’inconvénient : ce sont les plus précaires qui en souffrent le plus.
La recherche de vérité, scientifiquement éprouvée, est essentielle pour faire changer les choses.
Bravo et merci pour votre travail.
Beau travail de recherche , je noterais toute fois un point qui me chiffonne : Pogacar pèse moins de 70kg, ça fausse un peu ( genre beaucoup ) le calcul . Et je ne retrouve pas de paramètre de poids dans ce calculateur . Je me trompe ?
J’aimerais bien avoir la réponse également
Merci
Le poids du coureur est le premier paramètre demandé dans le calculateur de puissance…